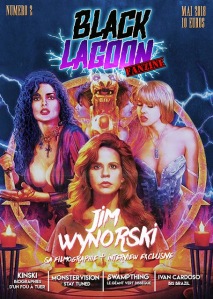Il n’est pas rare, en explorant la filmographie de Jess Franco de tomber sur plusieurs montages d’un même film distribués le plus souvent sous des titres différents. La plupart du temps, ces différentes versions sont le fruit d’un impératif commercial ou d’une stratégie pour contourner la censure (les versions habillées et déshabillées de certaines séquences de L’HORRIBLE DR. ORLOF ou des EXPÉRIENCES ÉROTIQUES DE FRANKENSTEIN) et n’altères pas ou très peu l’intégrité du produit. Il est quelques exceptions à cette règle lorsque c’est un autre que Franco qui se charge de tourner séquences alternatives et rallonges érotichiantes, mais ceci est une autre histoire. Ces altérations ne redéfinissent que partiellement la nature du film.
L’exemple de LA COMTESSE NOIRE est à ce titre assez parlant, puisqu’il se décline en trois versions distinctes : la première qui reflète le projet original de l’auteur et mêle la mélancolie gothique induite par la nature vampirique de son personnage principal à un fétichisme voyeur encouragé par les besoins peu orthodoxes de son vampire, la seconde, LES AVALEUSES qui fait fi d’une partie des dialogues de l’original et, comme son titre l’indique, est la version « hard » (LA COMTESSE PERVERSE eut aussi droit à ce traitement avec LES CROQUEUSES) et la troisième sortie sur les territoires anglophones sous le titre EROTIKILL et qui n’a pourtant plus rien d’érotique, le vampirisme ayant recouvré ses attributs traditionnels et le film y ayant perdu une vingtaine de minute, il s’agit de la version « purement horrifique ».
A d’autres moments, c’est au cœur même du film original que ces révisions s’attaquent, comme ce sera le cas avec AL OTRO LADO DEL ESPEJO (1973), distribué en France dans une version bien différente dirigée par Franco lui-même, LE MIROIR OBSCÈNE (où ce n’est plus le père de l’héroïne mais sa sœur qui hante le miroir titulaire). Ce n’est plus alors seulement à un montage expurgé ou épicé que nous avons à faire, mais bien à un nouveau film à part entières. LE SADIQUE DE NOTRE DAME (1979) est de cette catégorie allant jusqu’à n’être plus considéré par son réalisateur comme un produit dérivé du projet initial, mais bien comme la version définitive.
-

-

L’ossature et une bonne partie de la musculature d’un film de cinq ans son ainé, EXORCISME ET MESSES NOIRES (1974), constituent environ 70% du métrage du SADIQUE DE NOTRE DAME. Pour autant ce dernier n’est pas un simple remontage qui orienterait le premier un peu plus vers le sexe ou vers une chaste horreur et pour cause, ces deux remontages existent déjà depuis longtemps (respectivement SEXORCISME et DEMONIAC). LE SADIQUE DE NOTRE DAME est, à l’image de son titre, un recentrage sur le personnage principal incarné par Franco lui-même, ici avec cinq ans et quelques mèches grises de plus. La totalité du nouveau métrage (une trentaine de minutes) tourne autour du personnage de Paul Vogel, ce qui modifie significativement la tonalité du film et l’ancrage émotionnel du spectateur.
-

LE SADIQUE DE NOTRE DAME conserve les prémices d’EXORCISME ET MESSES NOIRES, à savoir le fait que Paul Vogel, fanatique de l’inquisition, est témoin, dans une cave parisienne reconvertie en boite branchée, d’un simulacre de messe noire et qu’il se fait une mission de sauver l’âme des participants en les envoyant ad patres. De ses exploits, Vogel tire des nouvelles qu’il espère faire publier dans une revue littéraire à sensation, Le Poignard et la Jarretière. La question de savoir si Vogel, visiblement dérangé, prend le spectacle de cabaret pour une véritable messe noire ou s’il considère simplement qu’on ne plaisante pas avec le diable et que ce genre de divertissement est un péché mortel en soi n’est jamais vraiment adressée, tout comme celle de savoir quel regard il porte sur les publications habituelles de la revue dans laquelle il espère être publié, et l’on est forcé de suivre la croisade du tueur en se fiant à sa morale biaisée, ce qui renforce le sentiment d’ambigüité. A cette base immuable, Franco ajoute un élément d’information capitale, à savoir que Vogel n’est plus seulement cet obsédé de la punition divine aux ambitions littéraires contrariées, mais un prêtre défroqué, soit plus seulement un être marginal par ses idéaux, mais un être rejeté par le milieu même qui a façonné sa folie. Franco pousse ici le pamphlet anticlérical à son paroxysme en suggérant que Vogel n’est pas seulement le bourreau mais aussi et surtout la victime.
Toutes les nouvelles scènes accentuent cette impression de solitude, de rejet et de marginalité, à commencer par la séquence d’ouverture qui voit Vogel se réveiller, après une nuit passée dans la rue, au milieu des clochards alors que passe un camion poubelle. Lorsqu’il traverse les rues, au milieu de la foule, il est toujours seul, les passants interloqués s’écartant du chemin de la caméra qui accapare leur attention, ne le regardent même pas, la foule ignore ce pauvre gars et l’acteur-réalisateur fait semblant de chercher lui-même à qui la caméra peut bien s’intéresser : une astuce simple mais efficace qui lui assure que personne ne s’intéresse à lui. D’autres scènes additionnelles voient Vogel se confier à un ancien collègue séminariste qui déplore les dérives de son camarade et qui malgré toute la compassion dont il fait preuve à son égard lui signifie sans ménagement que l’Eglise se lave désormais les mains de son cas. Cette absence de refuge pour Vogel se reflète dans le fait qu’il ait un jour choisit de dormir dehors plutôt que dans sa propre maison que l’on découvre plutôt cossue mais qui est le lieu de ses activités meurtrière et non celui du confort matériel ni du réconfort spirituel.
L’intégralité des scènes de fausses messes noires et la partouze façon bourgeois encanaillés qui suit l’une d’elles sont reprises presque telles quelles et on aura à nouveau le plaisir de voir Claude Sendron, réalisateur bien souvent responsable du caviardage made in Eurociné, mettre « de l’ordre à ces orgies » et répliquer ironiquement lorsque l’une des participantes l’enjoint d’y prendre part : « Oh non, ce n’est pas pour moi ». N’y aurait-il pas là de la part de Franco une petite pique en direction des Lesoeur et de leur manie d’engager d’autres cinéastes pour épicer ses films ? Mais Franco ne s’est pas contenté d’inclure ses nouvelles scènes clés à la structure existante d’EXORCISMES, il a totalement réorganisés le déroulement du récit, réordonnant les entrevues entre Vogel et le rédacteur en chef du Poignard et la Jarretière et sa secrétaire, Anne (Lina Romay) ainsi que l’avancement de l’enquête sur les meurtres de Notre Dame menée par Olivier Mathot. À la lumière des informations nouvelles sur Vogel, sa relation avec Anne en devient plus poignante et son conflit intérieur plus visible qu’il ne l’était en 74, un nouveau doublage souligne dans les réplique de Vogel le désir de trouver en Anne un esprit compréhensif, et rend l’échec de cette connexion spirituelle tant désirée encore plus douloureux.
-

Seule ombre au discrédit du SADIQUE DE NOTRE DAME, l’empêchant d’être bel et bien la version définitive de l’histoire de Paul Vogel : le destin de la pauvre Anne laissé sans suite. Si à la fin d’EXORCISME ET MESSES NOIRES, Anne était sauvée alors que Vogel était rattrapé par la police alors qu’il projetait de s’enfuir en la kidnappant, elle est ici toujours enfermée chez Vogel alors que celui-ci se rend à la police de son plein gré, repentant et résigné. L’adresse de Vogel n’ayant jamais été mentionnée par aucun autre personnage, il est permis de penser que personne n’est au fait du lieu de détention de la malheureuse, et il est assez déconcertant de constater qu’au moment de l’arrestation de Vogel personne ne fait allusion à la disparition de la jeune secrétaire. Il revient alors à notre mémoire qu’EXORCISME s’achevait cinq ans plus tôt avec un plan sur la plus haute fenêtre du manoir Vogel. Plan de clôture gratuit ou suggestion d’un dernier mystère irrésolu ? À la vision du SADIQUE DE NOTRE DAME, le dernier plan de son aîné revêt un caractère prophétique qui achève de nous convaincre qu’il n’y a pas de « version définitive » d’un film de Franco, mais bien mille pièces d’un puzzle en constante expansion et à jamais inachevé.
-

LE SADIQUE DE NOTRE DAME est à nouveau visible dans les meilleures conditions grâce à l’éditeur SEVERIN FILMS qui se fend d’une édition blu-ray exemplaire à tout point de vue.
Severin films et Jess Franco ont toujours fait bon ménage, ce ne sont pas leurs sorties DVD de MACUMBA SEXUAL, MANSION OF THE LIVING DEAD ou SEXUAL STORY OF O qui le démentirons. L’arrivée de la HD semble avoir stimulé leur volonté d’offrir des éditions « définitives » aux films de l’espagnol fou, et THE HOT NIGHTS OF LINDA avait ouvert le bal avec succès en 2013, mais c’est l’année 2018 qui se pose comme l’année francienne puisque l’éditeur nous a gratifié de trois sorties inespérées, remettant en lumières une période trop peu explorée de la filmographie de Jess Franco, il s’agit de SINFONIA EROTICA, TWO FEMALE SPIES WITH FLOWERED PANTIES et celui qui nous intéresse ici, THE SADIST OF NOTRE DAME aka LE SADIQUE DE NOTRE DAME.
Le film a fait l’objet d’un effort de restauration louable qui s’abstient de tout révisionnisme et évite de réduire le grain d’une image qui conserve son caractère d’époque et on ne peut que remercier l’éditeur de ne pas céder aux sirènes du « lissage » à outrance. On aura aussi la bonne surprise de retrouver le film dans sa version française, largement préférable au doublage anglais lui aussi proposé. Si le film demeure le principal intérêt, la section des suppléments est un argument d’achat des plus convaincants.
Autour du film lui-même, on aura le plaisir d’un entretien avec Stephen Thrower qui disserte de manière érudite sur les différences entre EXORCISME ET MESSES NOIRES et LE SADIQUE DE NOTRE DAME et sur la place de ce film dans la filmographie de Jess Franco. L’auteur de MURDEROUS PASSIONS : THE DELIRIOUS CINEMA OF JESUS FRANCO s’avère aussi passionnant à écouter qu’à lire et son approche encyclopédique, son analyse intuitive et interprétative peut tout aussi bien donner de nouvelles pistes de réflexions à l’aficionado de Franco que rendre accessible son œuvre foisonnante au novice. Malheureusement, en l’absence de sous-titre français, ce supplément ne pourra ravir complètement que l’anglophone confirmé. Il en va de même pour le bref commentaire audio de Robert Monell (webmaster du blog « I’m In A Jess Franco State Of Mind », référence en matière de francomania) qui se révèle un peu plus dispensable mais propose tout de même quelques infos intéressantes, notamment sur le casting.
Il y a tout de même de quoi satisfaire le spectateur non-anglophone, puisque c’est Alain Petit, auteur du monumental JESS FRANCO OU LES PROSPÉRITÉS DU BIS, qui revient sur la genèse du SADIQUE DE NOTRE DAME et sur les méthodes de productions d’Eurociné à l’époque ou Franco réalisait des films pour le compte de la compagnie de Marius Lesoeur, dans un entretien peut-être un tantinet court en regard de la somme d’informations à digérer. Le dernier supplément, mais non des moindres, vient sous la forme d’un documentaire consacré au Brady, cinéma de quartier parisien, célébré par Jacques Thorens dans son ouvrage LE BRADY, CINÉMA DES DAMNÉS paru en 2015. L’auteur du livre y revient sur l’histoire de la salle devenue mythique, sa programmation pour le moins hétéroclite et sa clientèle parfois inquiétante. Si ce bonus n’entretient pas de rapport direct avec LE SADIQUE DE NOTRE DAME, il offre une précieuse lucarne vers ce à quoi devait ressembler le circuit de distribution des films de Jess Franco dans les années 70 et permet d’achever cette redécouverte d’une œuvre méconnue du cinéaste par un petit voyage temporel bienvenu.
Gabriel Carton